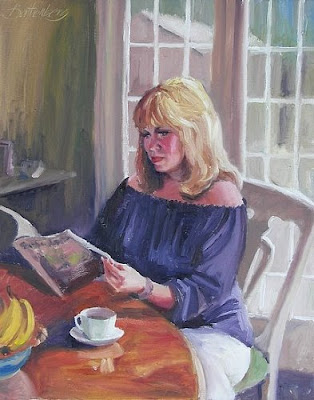Jacques Julliard L'Argent, Dieu et le Diable Flammarion
Alain Vircondelet Séraphine : De la peinture à la folie Albin Michel
 François Jonquet Daniel Sabine Wespieser
François Jonquet Daniel Sabine Wespieser
Daniel Emilfork, acteur incomparable au visage reconnaissable entre tous, jouissait d'une mystérieuse aura.
Au cinéma dans Casanova ou La Cité des enfants perdus, à la télévision dans Chéri Bibi, au théâtre dans Dommage qu'elle soit une putain monté par Visconti ou dans Richard Il de Chéreau, ou encore au détour de l'un de ses innombrables seconds rôles, il savait rendre inoubliables ses apparitions.
Lors de la dernière année de sa vie, cet homme solitaire, qui vivait reclus dans son appartement du haut de la butte Montmartre, s'est lié d'amitié avec François Jonquet.
Au cours de visites et de conversations téléphoniques, il lui a ouvert son cœur, raconté sa vie, romanesque, débordante, rythmée de grandes scènes et de portes claquées, de rencontres artistiques fabuleuses et de sanglantes ruptures.
Pauvre mais fastueux, orgueilleux et frondeur, dragueur toujours vert, ce dandy amoureux de l'excès s'accommodait mal d'une existence qui s'amenuisait lentement. Mais il savait faire basculer la vie dans le cocasse et l'absurde. II avait le pouvoir fabuleux de soudain l'enchanter.
Dans ce livre bref et dense, écrit d'une traite tout de suite après la mort du comédien, en octobre 2006, François Jonquet a restitué le personnage au plus près de sa vérité. II a donné à entendre sa voix.
Entre ces deux êtres que tout séparait, l'âge, le parcours, les origines, s'est nouée une relation tendre et profonde, que la fuite du temps accélérait. Le fragile vieil homme donnait à son cadet, qui à cette époque traversait un moment de faiblesse, de sa force et de sa bravoure. Daniel est un hommage tragique et drôle à un homme qui aura théâtralisé toute sa vie.
 Hélé Béji Nous, décolonisés Arléa
Hélé Béji Nous, décolonisés Arléa
" La décolonisation est la forme la plus instinctive et la plus avancée de la liberté. Elle est l'avant-garde de toutes les libertés. Mais elle est la plus malheureuse de toutes, car elle n'a pas tenu ses promesses...
Nous avions fait l'Histoire, nous étions au cœur de l'Histoire, et l'Histoire nous avait comblés à profusion.
Pourtant, après avoir reçu en héritage cette grâce miraculeuse, nous ne l'avons pas gardée. Qui nous l'a dérobée ?
Cette histoire était la nôtre et, si nous l'avons perdue, c'est de notre faute. Nous n'avons pas recouvré ce dont nous croyions avoir été spoliés, et nous avons dilapidé ce que nous avions reçu. "
Ces mots d'Hélé Béji donnent le ton de cet essai rigoureux sur la grande épopée de la décolonisation et ce qu'elle est devenue, un demi-siècle après. Cette brillante auto-analyse, si elle fait une part importante aux extraordinaires avancées qu'elle a permises, à commencer par la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, pointe aussi avec la lucidité du trait vécu les erreurs, les fourvoiements et les dévoiements qui en ont découlé.
Que reste-t-il de cette extraordinaire aspiration qui a porté tant de peuples vers leur indépendance ? Se pose alors l'incontournable question de la difficile harmonie entre l'aspiration politique et l'exercice du pouvoir.
Sans évitement ni compromis d'aucune sorte, Hélé Béji dresse le constat implacable de ce rendez-vous manqué avec la promesse de la souveraineté. Nous, décolonisés, par sa liberté critique, n'hésite pas à mettre le décolonisé face à ses responsabilités dans le destin du monde, et à l'obliger à un honnête examen de conscience s'il ne veut pas troquer ses vieilles servitudes contre de nouveaux esclavages.
S'il a incarné le visage de l'humain, il n'est pas à l'abri de l'attrait qu'il ressent pour l'inhumain. Mais fondera-t-il un nouvel humanisme ? Apportera-t-il sa lumière à l'équilibre du monde ?
 **Robert Muchembled Une histoire de la violence Seuil
**Robert Muchembled Une histoire de la violence Seuil
L'actualité place sans cesse la violence sur le devant de la scène. Thème important pour les sociologues et les politiques, elle est aussi un objet d'histoire.
À rebours du sentiment dominant, Robert Muchembled montre que la brutalité et l'homicide connaissent une baisse constante depuis le XIIIe siècle.
La théorie d'une " civilisation des mœurs ", d'un apprivoisement voire d'une sublimation progressive de la violence paraît donc fondée. Comment expliquer cette incontestable régression de l'agressivité ? Quels mécanismes l'Europe a-t-elle réussi à mettre en œuvre pour juguler la violence ?
Un contrôle social de plus en plus étroit des adolescents mâles et célibataires, doublé d'une éducation coercitive des mêmes classes d'âge fournissent les éléments centraux de l'explication.
Progressivement, la violence masculine disparaît de l'espace public pour se concentrer dans la sphère domestique, tandis qu'une vaste littérature populaire, ancêtre des médias de masse actuels, se voit chargée d'un rôle cathartique : ce sont les duels des Trois Mousquetaires ou de Pardaillan, mais aussi, dans le genre policier inventé au XIXe siècle, les crimes extraordinaires de Fantômas qui ont désormais à charge de traduire les pulsions violentes.
Les premières années du XXIe siècle semblent toutefois inaugurer une vigoureuse résurgence de la violence, notamment de la part des " jeunes de banlieues ". L'homme redeviendrait-il un loup pour l'homme ?
Source : LivresHebdo--Envoyé par Juan dans Prix-Litteraires : Le blog le 10/10/2008 09:20:00 P
 Note :
Note :
Pas de chance pour belezi, disparu de cette liste. Dommage, son livre est pourtant intéressant et passionnant.
Millet a également disparu,mais là, franchement, me laisse plutôt indifférente.
Juste jeté un oeil sur les livres que je n'avais pas eu le temps de voir, mais ne change pas vraiment ma liste de lecture.
****Charles Lewinsky Melnitz
***Dominique Jamet Un traître
**Ceridwen Dovey Les Liens du sang
**Gail Jones Pardon
**Sasa Stanisic Le Soldat et le Gramophone
 Jean-Louis Fournier, prix Femina 2008
Jean-Louis Fournier, prix Femina 2008 Le prix Femina du roman étranger 2008 a été attribué lundi à l'Italien Sandro Veronesi pour "Chaos calme" (Grasset)
Le prix Femina du roman étranger 2008 a été attribué lundi à l'Italien Sandro Veronesi pour "Chaos calme" (Grasset)  le Prix Femina de l'essai 2008 est revenu au comédien Denis Podalydès pour "Voix off" (Mercure de France), a d'autre part annoncé le jury.
le Prix Femina de l'essai 2008 est revenu au comédien Denis Podalydès pour "Voix off" (Mercure de France), a d'autre part annoncé le jury.  le Prix Femina de l'essai 2008 est revenu au comédien Denis Podalydès pour "Voix off" (Mercure de France), a d'autre part annoncé le jury.
le Prix Femina de l'essai 2008 est revenu au comédien Denis Podalydès pour "Voix off" (Mercure de France), a d'autre part annoncé le jury.