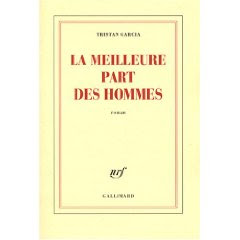Eh bien, sans surprise on trouve “A la Recherche du temps perdu”, de Proust, mais aussi “Absalon, Absalon !”, de Faulkner, et… mais oui, ”La Princesse de Clèves” (n’en déplaise à certains).
On vous a coupé les 100 palmarès en 10 fois 10 (un par jour) : première liste de listes dans 5 mn chrono.
*
SUR LE MEME THEME
Que lisent les écrivains ? De Clémence de Biéville à Michel Crépu 12 mars 2009
Que lisent les écrivains ? D’Olivier Adam à Pierre Bergounioux 12 mars 2009
SUR LE MEME THEME
Que lisent les écrivains ? De Clémence de Biéville à Michel Crépu 12 mars 2009
Que lisent les écrivains ? D’Olivier Adam à Pierre Bergounioux 12 mars 2009
*
Quels sont vos dix livres préférés ?
Quels sont vos dix livres préférés ?
C'est la question toute simple que nous avons posée à cent écrivains. Non pas dans l'idée de réaliser une enquête qui aurait valeur de sondage ou d'étude plus ou moins scientifique, mais pour tenter plus modestement de sentir d'où viennent, littérairement parlant, les écrivains français et francophones d'aujourd'hui.
Sous les auspices de quels grands auteurs se placent-ils ?
De quels livres, chefs-d'oeuvre incontestés ou ouvrages plus modestes, se sont-ils nourris et continuent-ils de s'alimenter ?
Pour savoir aussi, plus simplement, quels sont leurs livres de chevet, les livres de leur vie, avec la conviction qu'en des temps où les sombres augures annoncent la désaffection du public pour la littérature et la lecture il n'existe peut-être pas de prescripteurs plus efficaces que les écrivains eux-mêmes.
*
Les choix que nous ont confiés les cent auteurs sollicités témoignent d'abord d'une formidable diversité : plus de trois cents titres cités.
Les choix que nous ont confiés les cent auteurs sollicités témoignent d'abord d'une formidable diversité : plus de trois cents titres cités.
Et dans nombre de ces listes de dix livres chacune – parfois onze ou douze, mécompte à attribuer tantôt à l'inadvertance, tantôt à l'impossibilité radicale de s'en tenir à dix titres, tantôt encore à un esprit d'« indiscipline » revendiqué, comme c'est le cas pour Olivier Rolin ou Jean Hatzfeld –, une aimable cohabitation entre des livres phares du patrimoine littéraire mondial et des livres plus confidentiels, à la notoriété moins grande.
Autre évidence :
le critère linguistique n'est pas de mise pour nos écrivains, lorsqu'ils sont appelés à désigner leurs livres préférés. Ainsi, parmi les vingt auteurs les plus fréquemment cités, voit-on figurer autant d'étrangers que de français, Faulkner, Dostoïevski, Virginia Woolf, Joyce ou Kafka... côtoyant le plus naturellement du monde Flaubert, Céline, Stendhal ou Rimbaud.
A noter encore que ces sélections mettent en évidence le poids énorme du roman parmi les lectures de chevet de nos écrivains d'aujourd'hui : quelques poètes (Rimbaud, Baudelaire...) se glissent parmi les vingt auteurs les plus cités, Shakespeare et Beckett évitent au théâtre d'être totalement absent - encore faut-il signaler que Beckett est davantage présent au titre de ses romans que de son théâtre -, mais c'est à peu près tout. Seul Pierre Assouline, par ailleurs biographe d'Hergé, a inclus dans son choix de dix titres une bande dessinée : en l'occurrence Le Lotus bleu, une des aventures de Tintin.
Enfin, relevons que les contemporains ne sont pas absents, mais assez rares :
Yves Bonnefoy, Jean Echenoz (Ravel), Pierre Michon (Vies minuscules), Patrick Modiano (Un pedigree) et Philippe Sollers (Paradis) figurent, sans surprise, côté littérature française, parmi nos « contemporains capitaux ». Avec eux, plus inattendus peut-être, Jean-Jacques Schuhl (Rose poussière, parmi les livres préférés de Chloé Delaume), Xavier Houssin (16, rue d'Avelghem, choisi par Régis Jauffret) ou Alain Mabanckou (Verre cassé, cité par Gilbert Gatore), mais encore Pierre Pachet ou Renaud Camus... Et, côté étranger, Philip Roth, García Márquez, Ian McEwan, J.M. Coetzee ou l'admirable W.G. Sebald (mort en 2001)...
Une silhouette domine incontestablement :
Marcel Proust, A la recherche du temps perdu étant cité par un écrivain sur trois. Suit, en deuxième position, mais loin derrière la grande fresque proustienne, l'Ulysse de Joyce, qui ne figure plus que dans les choix de treize écrivains sur les cent interrogés.
Puis vient le diptyque d'Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Ce triomphe de Proust ne surprend pas vraiment l'essayiste et enseignant Olivier Decroix (1) : « A la Recherche du temps perdu est une sorte de terreau fertile pour les écrivains, comme l'écrivait Julien Gracq.
C'est un livre inépuisable, une œuvre qui ne finit jamais, qui est très diverse, par certains aspects encore très ancrée dans le XIXe siècle, par d'autres parfaitement moderne. Ce caractère inépuisable est aussi lié à la grande liberté de Proust, qui mélange au roman des passages qui relèvent de l'essai, de la réflexion sur l'art ou sur l'écriture, de l'autobiographie aussi.
Enfin, La Recherche est un livre qu'on peut lire plusieurs fois et à des âges différents en y trouvant, à chaque lecture, des choses nouvelles. Comme si on ne l'avait jamais lu. »
Sollicités eux aussi, il y a deux ans, pour désigner leurs livres préférés, cent vingt-cinq écrivains anglo-saxons (anglais, américains, australiens...) avaient choisi pour écrivain favori Tolstoï, dont les deux grands romans, Anna Karénine et Guerre et paix, étaient respectivement premier et troisième parmi les livres les plus cités (2).
Les accompagnaient, parmi les cinq premiers, Madame Bovary, de Flaubert, Lolita, de Nabokov et Les Aventures de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Suivaient Shakespeare, Fitzgerald et Gatsby le magnifique, La Recherche, les nouvelles de Tchekhov et le gros et merveilleux Middlemarch de George Eliot. Observant de près cette synthèse établie à partir des cent vingt-cinq sélections, un des commentateurs relevait : « La préférence collective, telle qu'elle apparaît dans cette liste, va clairement à de grands romans dramatiques qui parlent d'amour et de mort, et sont portés par des personnages inoubliables. »
Plutôt que vers les grandes fresques romanesques, leurs narrations confiantes et leurs héros formidablement incarnés, les écrivains français, du moins ceux que nous avons interrogés, inclinent, eux, vers les grands modernes du XXe siècle que sont Joyce, Kafka ou Woolf, manifestant plus de doute que d'assurance dans la suprématie du personnage et l'intérêt du roman en tant que pure narration.
« Tous ces auteurs, y compris Céline et Rimbaud, sont habités par une interrogation sur le sujet. Qu'est-ce qu'un personnage ? Qu'est-ce qu'un point de vue ? Qui parle ?
Le personnage, chez eux, est toujours très menacé. Ce sont des auteurs qui posent la question de l'identité.
Des auteurs, aussi, qui mettent en question le réel en en livrant une image déformée, loin du réalisme, pour essayer d'en dire quelque chose de neuf, d'inédit », analyse Olivier Decroix.
Ces interrogations sur le personnage et la perception du monde, qui courent tout au long du XXe siècle littéraire, demeureraient donc pleinement vivantes aujourd'hui pour les écrivains français, continue Olivier Decroix.
Qui ajoute : « Je suis frappé de voir que, il y a cinquante ans, dans son essai L'Ere du soupçon, Nathalie Sarraute citait déjà Flaubert, Proust, Dostoïevski parmi les auteurs sur lesquels l'écrivain devait s'appuyer pour rompre avec la littérature héritée du XIXe siècle (dont elle ne sauvait que Flaubert, honnissant en revanche Balzac) et inventer un nouveau roman.
Un demi-siècle plus tard, on retrouve le même trio, comme si l'idée de ce qui est moderne, ce qui est neuf, n'avait pas changé. Comme si on n'était pas sorti de cette interrogation méfiante sur le personnage traditionnel, tel qu'il existe dans la fiction réaliste. »
Mais peut-être faut-il arrêter là l'analyse.
Ne pas s'efforcer de tirer des enseignements généraux et collectifs de choix profondément individuels et souvent singuliers. Ne pas oublier que, nous faisant part de leurs dix livres préférés, un nombre important d'auteurs ont tenu à souligner que, s'ils avaient établi leur liste la veille ou quelques jours plus tard, elle aurait été différente.
Pour finir, pointons une curiosité imprévue et sympathique : la présence de La Princesse de Clèves dans ce « palmarès », en très bonne place. Référence évidente et sincère pour de nombreux auteurs, l'ouvrage de Mme de La Fayette bénéficie aussi sans doute d'un engouement conjoncturel, ironique et « militant », qu'on peut relier aux attaques répétées dont il a été la victime de la part de Nicolas Sarkozy depuis février 2006 (3).
L'hypothèse est corroborée par l'évolution des ventes du roman en librairie : de sept mille exemplaires par an, ses ventes, dans les trois collections de poche de Gallimard où le livre est notamment présent, ont brusquement doublé l'année dernière, occasionnant la réimpression inattendue du roman.
Marcel Proust (33 fois)
William Faulkner (24)
Gustave Flaubert (23)
Fiodor Dostoïevski (16)
Virginia Woolf (15)
James Joyce (14)
Franz Kafka (14)
Louis-Ferdinand Céline (13)
Samuel Beckett (11)
Arthur Rimbaud (11)
Stendhal (10)
Mme de La Fayette (9)
Léon Tolstoï (9)
Malcolm Lowry (9)
William Shakespeare (9)
Herman Melville (9)
Primo Levi (9)
Georges Bataille (9)
Jean Giono (9)
Charles Baudelaire (8)
Homère (9)
André Breton (8)
Albert Camus (8)
Miguel de Cervantès (8)
illustration : la lectrice de Maria Cuevas
A la recherche du temps perdu, de Marcel Proust (33 fois)
Ulysse, de Joyce (13)
Iliade et Odyssée, d’Homère (9)
La Princesse de Clèves, de Mme de La Fayette (9)
Le Bruit et la Fureur, de William Faukner (8)
Absalon, Absalon !, de William Faulkner (8)
Les Fleurs du mal, de Baudelaire (8)
Sous le volcan, de Malcolm Lowry (8)
Don Quichotte, de Miguel de Cervantès (8)
L’Education sentimentale, de Gustave Flaubert (7)
La Bible (6)
Fictions, de J.-L. Borges (6)
Journal, de Franz Kafka (6)
Moby Dick, de H. Melville (6)
Les Frères Karamazov, de Fiodor Dostoïevski (6)
Une saison en enfer, d’Arthur Rimbaud (6)
Anna Karénine, de Léon Tolstoï (5)
Correspondance, de Gustave Flaubert (5)
La Divine Comédie, de Dante (5)
Les Liaisons dangereuses, de Choderlos de Laclos (5)
Le Maître et Marguerite, de Mikhaïl Boulgakov (5)
Mémoires d’outre-tombe, de Chateaubriand (5)
Récits de la Kolyma, de Varlam Chalamov (5)
Si c’est un homme, de Primo Levi (5)
Voyage au bout de la nuit, de L.F. Céline (5)
illustration : les livres de Robert Gaudreau
.
Nathalie Crom
Télérama n° 3087
(1) Il est l'auteur notamment de l'essai “Le Romantisme” (avec Marie De Gandt, éd. Bibliothèque-Gallimard) et de l'édition commentée d'“Hernani”, de Victor Hugo, éd. FolioPlus-Classiques.
.
Nathalie Crom
Télérama n° 3087
(1) Il est l'auteur notamment de l'essai “Le Romantisme” (avec Marie De Gandt, éd. Bibliothèque-Gallimard) et de l'édition commentée d'“Hernani”, de Victor Hugo, éd. FolioPlus-Classiques.
(3) A propos de la présence de ce roman dans le programme d'un concours de recrutement de la fonction publique, Nicolas Sarkozy avait déclaré : “Un sadique ou un imbécile, choisissez, avait mis dans le programme d'interroger les concurrents sur La Princesse de Clèves. Je ne sais pas si cela vous est souvent arrivé de demander à la guichetière ce qu'elle pensait de La Princesse de Clèves... Imaginez un peu le spectacle !”
source : télérama